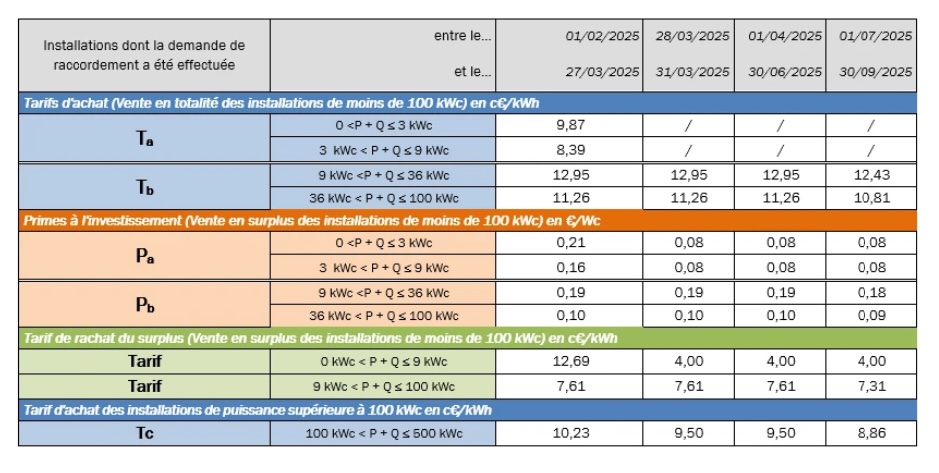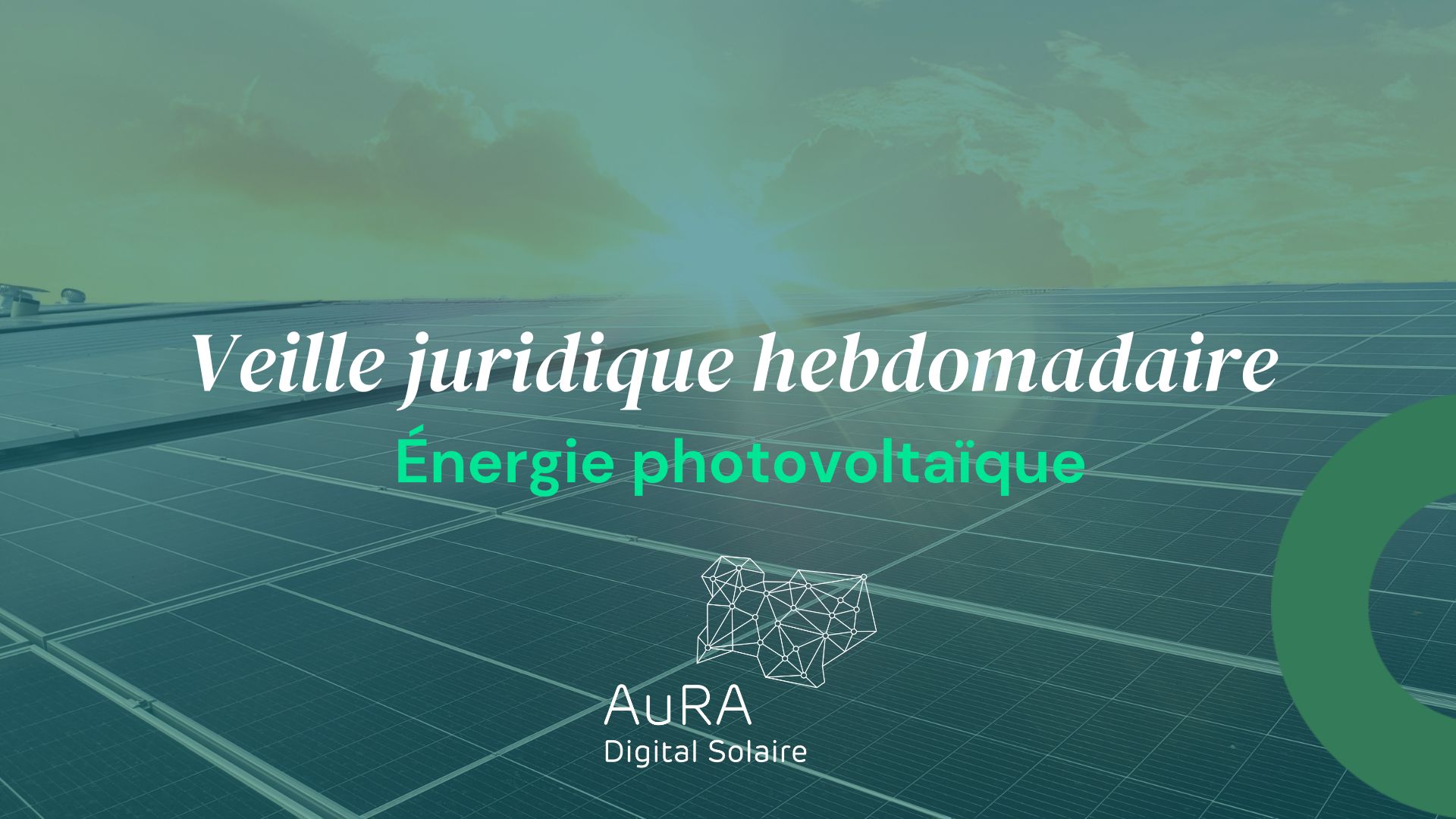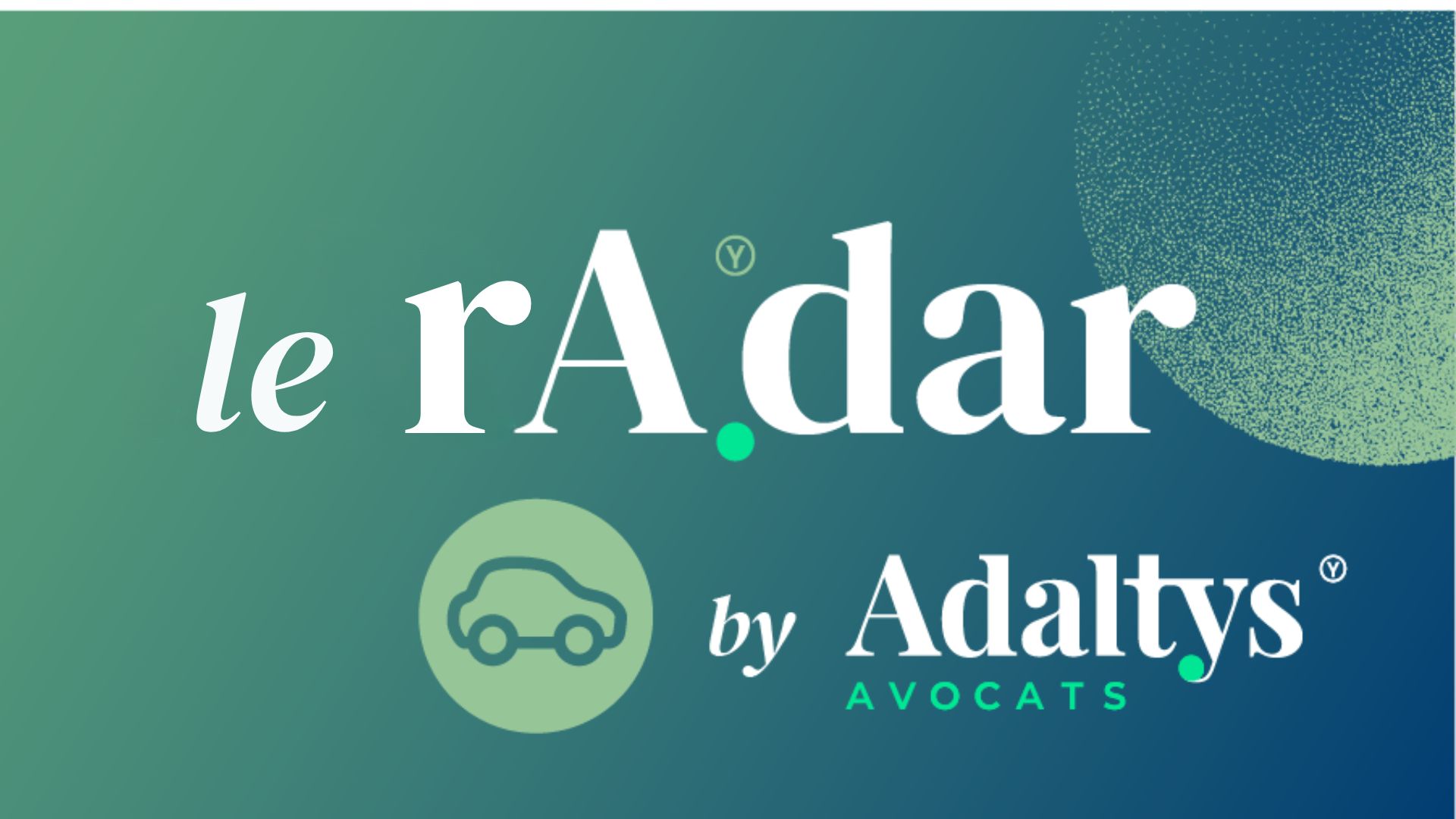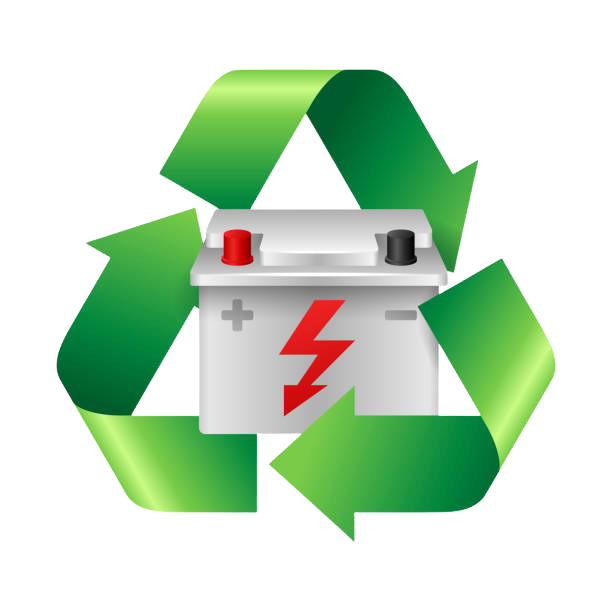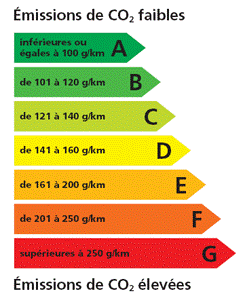Par décision en date du 1er avril 2025, la Commission européenne a sanctionné 15 constructeurs automobiles et l’Association des constructeurs européens automobiles (ACEA) pour leur participation à une entente de longue durée concernant le recyclage des VHU.
L’enquête menée par la Commission a en effet révélé qu’entre 2002 et 2017, soit pendant plus de 15 ans, 16 constructeurs automobiles se sont livrés à des pratiques concertées en matière de recyclage de VHU, en convenant en particulier :
- de ne pas payer les centres de traitement VHU, s’entendant pour considérer l’activité de recyclage des VHU comme une activité suffisamment rentable en soi (stratégie dite du « zéro frais de traitement ») et coordonnant dès lors leur comportement à l’égard de ces centres ;
- de ne pas faire de publicité sur la quantité de matériaux susceptibles d’être recyclés, valorisés et réutilisés dans les VHU, ni sur la quantité de matériaux recyclés utilisés dans les voitures neuves, afin d’empêcher les consommateurs de tenir compte de ces informations pour choisir un véhicule.
Ces pratiques s’inscrivaient en violation de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux VHU, qui prévoit que le dernier détenteur d’un VHU doit pouvoir s’en défaire gratuitement auprès d’une entreprise de démontage et que, si nécessaire, les constructeurs automobiles sont tenus d’en supporter les coûts. En outre, les consommateurs doivent être informés des performances des voitures neuves en matière de recyclage.
Des amendes allant de 1 à 127, 7 millions d’euros ont ainsi été prononcées par la Commission européenne à l’encontre des constructeurs ayant participé à l’entente, en tenant compte de divers éléments, parmi lesquels : le nombre de véhicules concernés, la nature de l’infraction, son étendue géographique et sa durée.
L’ACEA ayant organisé les réunions entre constructeurs a également été condamnée à hauteur de 500 000 € pour son rôle de facilitateur de l’entente.
Mercedes-Benz qui a révélé l’entente a, en revanche, échappé à l’amende, dans le cadre du programme de clémence. Stellantis, Ford et Mitsubishi ont quant à elles bénéficié d’une réduction de leur amende au titre de leur coopération avec la Commission.
Dans la lignée de cette décision, l’Autorité de concurrence anglaise (‘Competition and Markets Authority’) a d’ores et déjà adopté une décision condamnant ces pratiques au regard du droit britannique de la concurrence, ce qui inspirera peut-être d’autres autorités de concurrence nationales.
La décision de la Commission ouvre en outre la voie à d’éventuelles actions en justice devant les juridictions locales pour les entreprises et particuliers ayant subi un préjudice du fait de cette entente.
Le dossier n’est donc pas clos et il ne peut être exclu qu’il influence le mode de fonctionnement de l’éco-organisme et des systèmes individuels récemment mis en place par les constructeurs automobiles au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur.
3/ Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies (MC)
Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.
En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].
Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].
La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].
Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].
Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.
Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».
[1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
[2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)
[3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12
[4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15
[5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812
[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051
[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456
[8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19